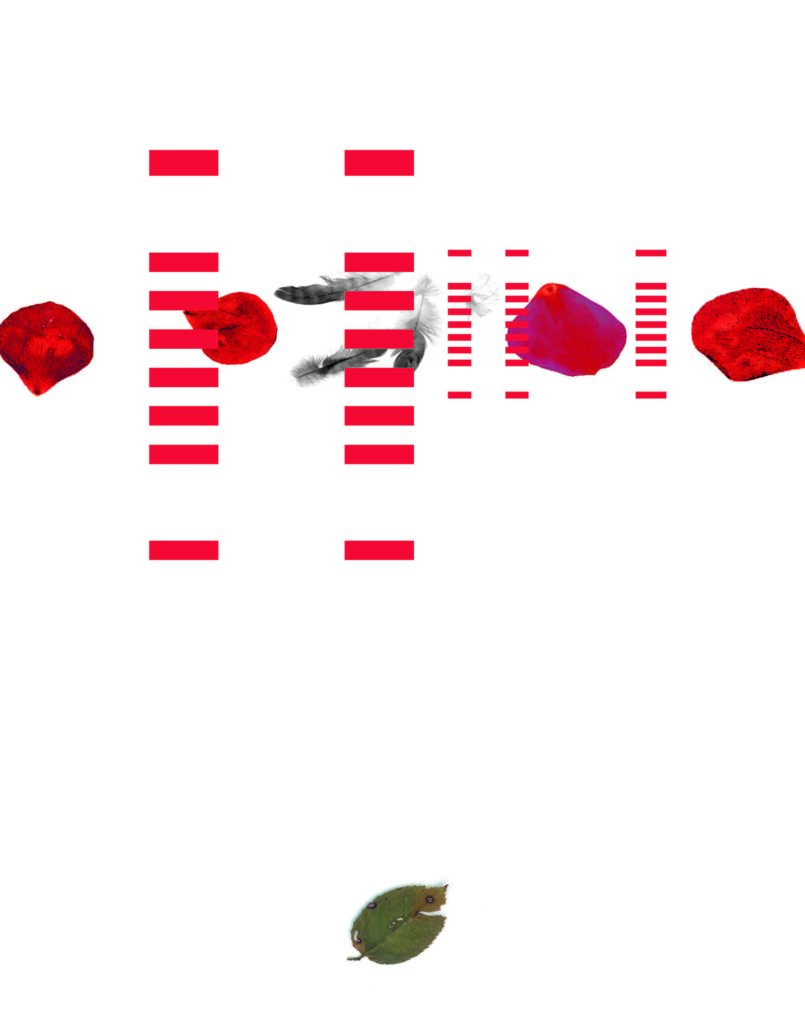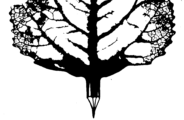En 1999, j’assumais la communication générale du Palais des Beaux-Arts de Lille et donc de l’exposition Goya
À mon initiative, sous ma direction artistique et conception visuelle, ce calendrier a été réalisé en marge de l’exposition Goya, organisée par la Réunion des Musées Nationaux, la Ville de Lille – le Palais des Beaux-Arts de Lille, et le Philadelphia Museum of Art, ce calendrier est une auto-production dans le cadre d’un partenariat établi avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, son impression, par l’imprimerie Deschamps Arts Graphiques est travail de facture artistique, (tons directs, vernis mat etc).
Sa conception se définit comme une mise en forme plastique des oppositions structurelles qui régissent les trois tableaux emblématiques de l’exposition :
– vu/non vu,
– su/non su,
– donné à voir, ordre des significations explicites/donner à penser, ordre des significations implicites,
Les remarquables analyses des tableaux ont été rédigées par François Legendre, sémiologue et historien d’art.
Ce calendrier, plusieurs fois primé, est aujourd’hui introuvable. Trois autres lui ont fait suite « L’an 2000 » « Spinoza » et « Mozart » ces quatre documents étant des travaux personnels hors de toutes commandes.


Le regard du premier âge de la vie
Le portrait est un instant figé, condensation de la trajectoire existentielle du sujet peint. Un enfant portraitisé en pied, vêtu de ses plus beaux atours, regarde, songeur, dans le vague.
Cet enfant est au monde comme l’est le premier âge de la vie, avec une perception émotive de la couleur : le rouge vif de son étoffe semble l’éveiller. Mais, en même temps, il est contraint dans une pose solennelle, un jeu d’apparences sociales qui le fragilise. Il est à la fois présent et absent au monde. Il joue avec une pie attachée à un fil, mais lui-même est joué par le peintre, comme une poupée captive.
Ce portrait n’est pas celui de l’innocence. Le peintre joue avec l’image sociale de l’enfant; l’enfant joue avec la liberté des oiseaux — les uns, en cage, en sont privés, l’autre, en laisse, en est frustré —; l’oiseau, enfin, joue avec un papier sur lequel Francisco de Goya, sous l’emblème de la palette et des pinceaux, a signé son oeuvre. La mise en abîme aboutit au monogramme, mais le monogramme renvoie au jeu pictural; et notre regard, tel l’oiseau, reste prisonnier de cette circularité du sens au référent.
Une inquiétude point. A gauche sont tapis trois chats, aux regards avides, qui semblent vouloir dévorer le jouet de l’enfant. Créatures maléfiques pour Goya, ils génèrent une tension. Métaphoriquement, ils menacent l’enfant dans son bonheur insouciant et sa destinée future. Sémantiquement, ils fondent la relation ambiguë proie-prédateur qui construit le discours social du tableau. Picturalement, ils menacent l’unité des apparences formelles de la composition : l’écart entre le regard affectif de l’enfant et le regard avide des chats devient intenable.
Don Manuel Osorio Manrique de Zuñiga (vers 1788)
Huile sur toile, 127 x 101 cm
The Jules Bache Collection – Numéroté : 49.7.41
© New York, Metropolitan Museum of Art


Le regard au deuxième âge de la vie
La scène épistolaire entre en peinture comme le Cheval de Troie de l’invisible, dans un art du visible par essence et substance : le contenu de la lettre est inconnu, dérobé à l’investigation inquiète du regard.
Cette intrusion de l’invisible affecte les significations mêmes du tableau, en ce sens que le paradigme déterminant qu’est le contenu de la lettre, investit de ses possibles toute la construction signifiante de l’oeuvre. En somme, ce qui est absent conditionne ce qui est présent, l’invisible assujettit le visible.
Le paradoxe de Baudelaire selon lequel :
« la peinture est l’art le plus proche de l’invisible »
se vérifie une nouvelle fois. Dans Les Jeunes ou La lettre, Goya duplique la censure. Les deux femmes s’isolent des deux groupes de l’arrière-plan, l’un exclusivement féminin au lavoir, l’autre mixte, où les conversations, peut-être même les commérages sur ce qu’est supposé contenir la lettre, vont bon train. La femme de gauche ouvre et oriente son ombrelle, comme pour mieux dérober le contenu de la lettre à d’autres regards possibles : le nôtre, voire ce soleil indiscret, probable métaphore du regard divin.
Pourtant, ce qui est censuré dans cette double rétention du visible, réapparaît ailleurs dans le tableau, grâce aux discontinuités de l’ordre invisible : au devant de l’ombrelle, le soleil perce, en un éclat lubrique, pour s’épancher sur la poitrine érectile de la liseuse, dont les seins enveloppés d’un voile lacté s’ouvrent au visible, s’offrent au monde et, en premier lieu, à notre regard désirant. Allusion/élision au contenu galant de la lettre — mais rien n’est sûr, l’invisible résiste malgré tout à l’évidence érotique de ce fragment — par laquelle cette jeune femme resplendissante, au deuxième âge de la vie, représente l’enjeu même des lectures désirantes de l’oeuvre : désir de lire la lettre, désir de regarder donc de posséder Le portrait est un instant figé, condensation de la trajectoire existentielle du sujet peint. Un enfant portraitisé en pied, vêtu de ses plus beaux atours, regarde, songeur, dans le vague., désir de l’amant inconnu qui explicite son désir par une lettre dont le contenu reste, pour nous, nécessairement implicite.
Plus que la portée relative des indices sur le contenu supposé de la lettre, indices qui appartiennent à l’ordre visible de la peinture, la signification de ce tableau se construit et se dé-construit successivement autour du contenu caché de la lettre, indice contradictoire d’une absence et d’une présence : absence charnelle de l’amant et présence épistolaire de son désir.
L’invisible contenu de la lettre procède donc d’une absence plus structurante encore, celle de son auteur. La signification globale de l’oeuvre se fonde sur cette double absence, cette causalité de l’invisible, que le regard désirant, frustré de l’incertitude inhérente à sa vision-lecture contrariée, s’empresse de combler.
La Lettre ou Les Jeunes (vers 1814-1819), Huile sur toile, 181 x 122 cm Numéroté, b.g. : C 103, © Lille, Musée des Beaux-Arts


Le miroir du troisième âge de la vie
L’élément signifiant de ce tableau – sa clef d’interprétation – est le miroir. Dans la peinture occidentale moderne, le miroir, ou la surface réfléchissante, recouvre deux fonctions : une fonction narcissique, par laquelle le sujet réfléchi s’absorbe dans la contemplation amoureuse de son image, et une fonction temporelle d’accélération, par laquelle le miroir vieillit le visage qui s’y reflète, altère l’apparence et met en péril l’intégrité du sujet.
Le miroir des Vieilles accélère radicalement le temps, à un point tel que ces deux femmes outrepassent le dernier âge de la vie pour confiner à l’outre-tombe ; leur condition de mortelles est signifiée par un masque cadavérique qui décompose leur visage à fleur d’os. Pourtant, l’activité de ces vieilles est paradoxale : bien que cadavérisées, elles se regardent autosatisfaites dans le miroir; un tel décalage procède, en fait, de la prééminence de la fonction narcissique : maquillées à outrance, vêtues de leur plus belle toilette de jeunesse, les deux coquettes accomplissent, à travers le miroir, un acte d’autoérotisme morbide. En cela, ces deux femmes sont tellement habitées par le désir de mort que leur identification relève de l’allégorie. La vieille de gauche aux orbites creusées, vêtue de noir et de grenat, semble personnifier la Mort qui tend le miroir de la fin à la vivante sursitaire, parée de blanc pour la noce funèbre.
Derrière, Thanatos ailé tient le balai, parodie du flambeau qui la guidera dans la topographie de l’Hadès. L’ultime question est posée crûment au revers du miroir : « que tal? » « comment ça va? » Question par laquelle, et contre laquelle, la vieille coquette se jauge encore à l’article de la mort. Un surcroît d’Eros pour conjurer – ou s’offrir? – à Thanatos.
Tout dans cette construction thanatographique semble montré; mais une image absolue manque :
que voient les vieilles dans le miroir? Ce que nous voyons d’elles dans le tableau? Leur beauté perdue de jeunes filles? Ou leur futur proche de cadavres? Cette auto-contemplation procède assurément du thème classique de la vanité, transposé en une esthétique de la dérision. Pour autant, sommes-nous certains qu’il y ait même une surface réfléchissante de l’autre côté du miroir? Sommes-nous certains que la mort soit un simple reflet de la vie, même dans la laideur?. La peinture questionne, elle ne répond pas.
Le Temps ou Les Vieilles (vers 1808-1812) Huile sur toile, 181 x 125 cm
Numéroté, b.g. : X 23
© Lille, Musée des Beaux-Arts